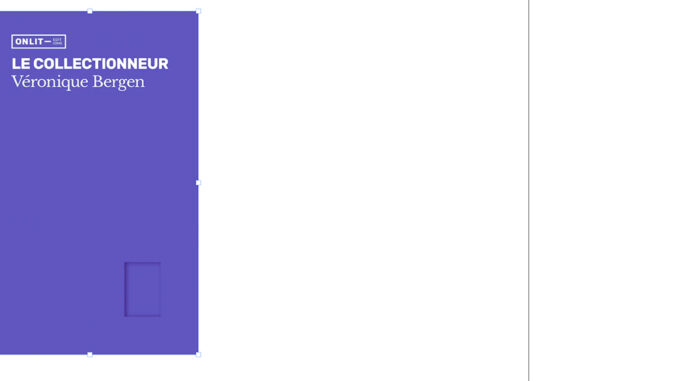
En imaginant les affres d’un héritier d’une collection d’œuvres spoliées par les nazis, Véronique Bergen investigue, révèle, dresse des portraits, questionne, fait parler les œuvres dans une fiction aussi grave que truculente, point d’orgue d’une singularité littéraire.
Par Claude Lorent
Le sujet est d’actualité et fait apparaître autant de problèmes que de polémiques et d’avis divergents surtout au niveau des Etats et des institutions muséales : la restitution des œuvres d’art estimées volées ou frauduleusement, illégalement acquises. Pas question ici de colonialisme ou de rapine spectaculaire. Le sujet est bien circonscrit : il s’agit de la spoliation par les nazis des œuvres d’art dans les pays conquis. Le pitch est parfaitement résumé en quatrième de couverture : « À la mort de son oncle, Andréas hérite d’une collection clandestine : des centaines de toiles volées sous le Troisième Reich. Matisse, Kirchner, Klimt, Cézanne… Chaque tableau devient un miroir, un vertige, une accusation ». L’auteure, Véronique Bergen que l’on ne présente plus aux lecteurs du Flux News, avec une inouïe habilité voyage dans les méandres de l’histoire sordide perpétrée tout au long de la seconde guerre mondiale en relatant principalement la constitution des collections d’art d’Hitler et de Goering. A la précision historique de ces rapts effectués dans les familles juives par les sbires des deux commanditaires, mais aussi par des intermédiaires marchands d’art et autres aussi peu scrupuleux que vénaux, l’auteur mêle une fiction qui anime l’ouvrage selon un fil d’Ariane narratif subtilement caviardé de références précises, de noms, de détails ainsi que de réflexions, de questions à caractère philosophique qui les poussent en profondeur. On taira l’intrigue pour la laisser découvrir car si elle n’est pas l’essentiel elle permet de faire émerger des interrogations, des remarques, des idées à creuser, qui donnent une ampleur inattendue au sujet, jusqu’à aboutir à des considérations ancrées dans l’aujourd’hui.
Pour faire saliver toutes les ramifications du cerveau du lecteur, on pointera quelques brefs extraits choisis. Passant des années mil neuf cent trente et quarante, elle évoque « l’opération Déluge d’al-Aqsa le 7 octobre, l’attaque orchestrée par le Hamas (…). Réveil des traumatisme générationnels, panique obsidionale en ce samedi noir, symbolique des dates de l’Histoire (…) ; La paix n’est plus qu’un mirage ». Elle évoque Goering et son directeur de la collection, Walter Hofer, et note l’amateur « des parties de chasse (…). Gibier des forêts profondes, gibier juif, nulle différence ». La voici traitants des pontes du IIIe Reich : « Chez certains, les digues éthiques sont rompues. Ils bénissent ces temps troubles qui balaient le surmoi, qui pulvérisent les bases anthropologiques, les interdits formant le socle du vivre ensemble. La guerre, pour eux, c’est la cour de récréation, lavée de toutes les inhibitions (…). C’est frotter éros contre le corps de thanatos (…) ». Et aussi cette insertion sur une part de l’art contemporain : « Les arts plastiques, made in plastique, sont devenus l’épiphénomène du néolibéralisme dévastateur. La spoliation des œuvres d’art a changé de visage, le monde est régi par des cueilleurs, non pas de pois, mais de fric, dominé par des chasseurs ivres de richesses matérielles (…) ».
L’ouvrage est passionnant car il se lit tel un récit que raconterait de vive voix l’auteure à un public totalement conquis tant par le sujet que par le langage et une gestuelle, des tonalités, des emportements, des émotions que l’on imagine volontiers. La lecture que l’on n’a pas envie d’interrompre, devient une écoute attentive de faits particulièrement vivants. Véronique Bergen, par sa verve, impose des présences physiques, la sienne et celles des personnages clés, mais surtout et c’est là d’une grande singularité, celles des œuvres, peintures principalement, dont il est questions. Son recours à la personnification, à la parole, est un coup de maître pour nous faire partager et faire vivre, les situations et les œuvres.
Autres extraits. A propos du « portrait de mademoiselle X. par Matisse, de la femme nue de Klimt : (…) mes yeux caressent leurs courbes sensuelles, ma voix apaise leur blues de midinettes ivres de séduction. Dès le premier jour de notre rencontre, ces lolitas m’ont dragué, impudiques baby dolls allumant les libidos, en quête d’orgasmes et de climax érotiques ». Concernant Klimt, elle rappelle aussi « Le tollé, le scandale suscité par les panneaux La Philosophie, La Médecine, la révulsion avec laquelle l’Université de Vienne les accueillit entraîna leur tombée en disgrâce. Le souffle de l’érotisme, la nudité des corps, l’anti-académisme de leurs compositions leur valu d’être refusées en 1903 ». Plus loin, l’auteure pose l’impertinente question en faisant parler les chefs-d’œuvre saisis par les nazis : « Avons-nous perdu de notre innocence, de notre splendeur d’avoir correspondu aux critères esthétiques du national-socialisme, d’avoir été convoités par Hitler, par Goering ? Que dit de nous, de notre être profond, le fait d’avoir été encensés par les planificateurs de la Solution finale ? D’avoir représenté la quintessence de l’art aryen (…) ».
On l’aura compris, l’ouvrage, bien qu’à caractère historique et artistique, et il regorge de renseignements, est à part entière une œuvre littéraire de premier plan qui appartient à cette petite frange des vrais irréguliers du langage spécifiquement belges. Ces rares irréductibles qui adorent faire la nique à la bienséance langagière. Loin des institutionnels administratifs et autres académiques, elle se réalise pleinement dans les affinités très sélectives comptant les Jean-Pierre Verheggen, Henri Michaux, Pierre Mertens, voire les pataphysiciens André Blavier (également oulipien) et André Stas. C’est dire qu’elle déploie avec une certaine jubilation un peu iconoclaste, une langue truculente, jouissive, épissée, une langue de chair autant que d’esprit. Une langue sans frontière, sans hiérarchie, sans tabou, qui jongle avec les vérités historiques sous tension d’onirisme, de fantasmes, d’érotisme et de sexualité. Une langue, et c’est étincelant, qui tord le cou aux histoires de l’art guindées, aux interprétations trop soumises aux carcans écartant les vibrations corporelles incluant l’intime. Une langue libre, libertine, indisciplinée, métissée car constamment infiltrée par une poétique littéraire inventive qui percute autant qu’elle émeut. Une langue savoureuse. Une langue lubrique, juste, très juste mais sauvageonne et inattendue en ces circonstances. L’Art en ses expressions plasticiennes et littéraires est à toutes les pages.
Quant au titre : « (…) une collection, c’est l’incarnation par essence illimitée d’une passion, c’est une névrose d’accumulation érudite, viscérale et compulsive ».
Une dernière pour la route qui mène chez le libraire. « Des cent mille œuvres pillées par les nazis, près de quarante-cinq mille ont été restituées après la guerre. Où se cachent les milliers qui n’ont pas retrouvé le chemin du bercail ? ». Bonne question.
Le collectionneur, Véronique Bergen, 262 p., septembre 2025, ONLIT éditions, 22,90 €.
une juste et très belle approche de ce roman de Véronique Bergen.
C’est bien plus qu’un roman que de questions sur les oeuvres portées disparues ?
L’ Art et son empire de passions !!!!
c’est un livre passionnant